



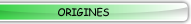










Fromond de Paris
En 754 le roi Pépin avait fait don du territoire de Palaiseau aux moines de Saint Germain des prés. En 950 Hugues-le-Grand, père du futur Hugues Capet et abbé de l’abbaye parisienne confiait la seigneurie de Palaiseau à son compagnon Guérin 1er de Paris. En 1056, le roi Henri 1er nomme Fromond de Paris seigneur de Villa Bona. Il est le frère de Garnier, seigneur de Palaiseau. C’est la féodalisation des terres. Villebon devient alors une seigneurie. Ce découpage du territoire permet de mieux contrôler le domaine royal. Au sud de Paris, le long de l’axe principal qu’est la route d’Orléans, de nouvelles forteresses sont créées, confiées à des familiers des rois. Le seigneur Fromond élève alors peut-être son donjon de bois, entouré d’un enclos fossoyé, à proximité du territoire occupé par l’ancienne villa gallo-romaine, sur l’actuel domaine du château.
L’abbaye Notre Dame de Longpont
En 991 le roi Hugues Capet avait autorisé le garde forestier Thibault à édifier le château de Montlhéry. Son fils, Guy 1er de Montlhéry, également seigneur de Champlan, en grande estime auprès du roi Philippe 1er, en reçut en 1062 l’autorisation de fonder l’abbaye de Longpont, projetée par son épouse Hodierne de Gometz. Le Cartulaire de Notre Dame de Longpont contient beaucoup de renseignements sur les premiers seigneurs de Villebon. Gautier de Villa Bona y est cité vers 1090 comme témoin pour les religieux d’un don que fait Milon, châtelain de Montlhéry, de terres à Montlhéry et à Fous (Villefeu ?) près d’Orsay. Dans le même texte son fils Hugues, est également cité comme témoin. En 1080, on trouve comme premier seigneur connu de Saulx, Gerardus de Sauz, témoin d’une donation. Aszo de Villa Bona et Gautier de Villa Bona sont témoins vers 1100, à la donation de Symon d’Orsay. Le prénom Aszo est très répandu au XIIe siècle. Il est très utilisé dans la grande famille proche des rois. Ainsi Ebrard d’Étampes, vers 1100, a deux fils, Aszo et Grimaud, qui consentent à la donation faite par leur cousin Arnulf, de Longjumeau, soit un demi arpent de vigne près de Champlan. Azzo, Aszon ou Aszo, est probablement un prénom d’origine danoise (Viking), qui perdura dans les famille nobles, dans les régions conquises par le Normands : par exemple Aszon est le prénom de princes italiens au XIVe siècle. Cela a été illustré par le cinéma : Adso de Merkel, jeune moine franciscain, accompagne son maître en 1327, dans sa visite à un monastère bénédictin dans les Alpes italiennes (film Le nom de la rose, d’après le roman d’Humberto Eco).
Hugo de Villa Bona, fils de Gautier, est grièvement malade vers 1105. Sur son lit de mort il donne "à Dieu et à Sainte Marie de Longpont" un arpent de pré et un domaine, dans lequel se trouve un ouvrier agricole, ainsi que la dîme des revenus de sa châtaigneraie, sauf la vigne que son père Gautier retient en usufruit. La femme d’Hugues s’appelle Mélisande et sa sœur est l’épouse de Vivien de Corbeil ; parmi les témoins se trouvent Guy de Linas et les chevalier Anseius et Morcherius. Gautier, fils d’Aszo, est chevalier, seigneur de Villebon vers 1117. C’est en 1122 que l’église Sainte Marie apparaît dans une bulle du Pape Calixte II, confirmant l’installation d’un prieuré des moines de Saint-Florent de Saumur à Saulx. Les Chartreux viendront s’installer à Saulx en 1264.
Hugues de Villabona, petit-fils d’Aszo, apparaît en 1131, comme témoin lors d’une donation de terres à Saclay, route de Châteaufort, près d’Orsigny, par le Roi Louis VI le gros, à l’hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem. A cette époque les croisades, adoptées par le Concile de Clermont, poussent à la guerre sainte les seigneurs ; ceux de Villebon y participeront. Pierre l’Ermite prêcha la première en 1095, Bernard la seconde en 1147.
Guillaume de Villabona, fils d’Aszo, apparaît vers 1140. Sous Philippe Auguste (1180-1223) le registre de la chambre des comptes cite le chevalier Guillaume de Villabon, qui doit le service de garde à Montlhéry. Cette notation du nom (villa bona > villa bon) montre bien l’évolution intermédiaire qui aboutira à Villebon.
La Bretèche
La route de Palaiseau à Longjumeau ne fut créée que vers 1780. Le village le plus voisin du village de Villebon est Champlan, de l’autre côté de l’Yvette et de la Morte-Eau. Sur un plan terrier de Saulx de 1730 le chemin de la ruelle Boutillier (aujourd’hui déformé en Boutigny) joignant Saulx à Champlan passe l’Yvette sur la Planche de la Folie, à proximité du bout du Parc de Villebon. A cet endroit, des édifices et des murs évoquent une porterie à l’emplacement où se trouvait peut-être, en lien avec le donjon médiéval, une bretèche, construction en bois protégeant une ouverture. Cette bretèche n’existe plus mais des noms de lieux-dits la rappellent, à Villebon, la plaine de la Bretèche et à Champlan, le moulin de la Bretèche.
Guillaume de Villabon (env. 1130-1200)
Chevalier en 1146, il doit comme vassal du roi, deux mois de garde par an à la châtellenie de Montlhéry. La forteresse, démantelée en 1118 par Louis VI le gros, était devenue une résidence royale. Le roi Philippe II Auguste s’y rendait souvent. Continuateur de Louis VI et Louis VII, il mena d’innombrables actions, mariages ou batailles pour agrandir le royaume. Il obtint l’Artois en épousant Isabelle de Hainaut en avril 1180, puis en battant le comte de Flandres en 1185, il acquis les comtés d’Amiens, de Montdidier et les châtellenies de Roye et Thourotte. En 1187 il prit une partie du Vermandois et maria sa fille à Jean sans terre, fils d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. Cela alors même que contre lui il soutenait ses fils révoltés Henri le jeune et Geoffroi. Ancienne épouse de Louis VII, devenue celle d’Henri II, la reine Aliénor, Duchesse d’Aquitaine et Comtesse de Poitou, voulait de son côté unir les deux royaumes au profit de ses fils, particulièrement de Richard cœur de lion, devenu roi d’Angleterre à la mort d’Henri II, le 6 juillet 1189.
La 3° croisade (1189-1192)
L’Empereur Frédéric Barberousse et les souverains de France, Philippe Ier Auguste, de Gènes, et d’Angleterre, Richard Cœur de lion, de Marseille, partent pour la troisième croisade, alors que Saladin vient de reprendre Jérusalem. Frédéric se noie en Cilicie ; fâché à la suite d’un partage de butin avec Richard, Philippe Auguste, prétend être malade et revient en France. Richard s'empare de l'île de Chypre en 1191, qu'il vend aux Templiers, puis de Saint-Jean-d'Acre en 1191. Chef unique de la Croisade, il remporte la victoire d'Arsuf sur Saladin le 7 septembre 1191. Il marche sur Jaffa mais échoue en 1191 aux portes de Jérusalem. Il signe une trêve de trois ans puis il rentre en Europe pour déjouer les intrigues de Philippe II Auguste, devenu l'allié de son frère Jean sans Terre. Échoué sur les côtes dalmates en raison d'une tempête il tente de traverser sous un déguisement les lignes de son ennemi, le duc d'Autriche. L'empereur Henri VI le fait prisonnier de mars 1193 à mars 1194. Richard dut payer une lourde rançon pour rentrer en Angleterre.
Il est probable que Guillaume de Villabon partit lui aussi, accompagnant en Orient son roi… mais lequel ? La question mérite d’être posée !
Une monnaie de Richard Cœur de lion (1189-1199) à Villefeu
Un chercheur a trouvé à Villefeu, en mars 1999, une petite pièce émise par le Roi Richard cœur de lion, donc entre 1189 et 1199. Il s’agit d’un denier d’argent frappé par le Comté de Poitou. A l’avers une croix cantonnée d’un annelet et la légende + (RIC)ARDVS REX et au revers PIC(T)AVIE(N)SIS en trois lignes. Huit cents ans après, cette trouvaille pose un petit problème. Si ce site est un fief français, comment se fait-il qu’une monnaie anglaise y soit trouvée ? Une transaction a-t-elle eu lieu là ? Un voyageur étranger, soldat ou pèlerin est-il passé par ce lieu et pourquoi ? L’importance du site en est renforcée.
Ou bien Villefeu est-elle alors détenue par des alliés de Richard Cœur de lion ? Villefeu, un site fortifié en lien avec Château Gaillard, l’énorme château fort au bord de la Seine, défendant Rouen, que Richard construisit en deux ans (1197-1198), grâce au travail de 6000 ouvriers ? En tout cas Richard obtiendra une victoire éclatante sur les Français à Courcelles le 28 septembre 1198. Philippe II Auguste signera la trêve de Vernon, mais Richard, parti pour raisonner son vassal, le vicomte de Limoges, sera blessé à mort par les tirs d'un carreau d'arbalète devant le château de Châlus le 6 avril 1199.
Il semble bien que Villefeu soit à nouveau par cette découverte source de questions difficiles à résoudre. C’est à donc à suivre…
Pierre GÉRARD
La vie à Villebon du XI° au XIII° siècles (1)
Au temps des premiers seigneurs, grâce aux archives (cartulaires, polyptiques, censiers et terriers), mais aussi aux études générales sur l’Ile-de-France, il est possible d’entrevoir la configuration du territoire, donc la vie quotidienne.
Les premiers seigneurs de Villebon sont des laïcs, représentants du roi, nommés pour contrôler leurs gens et exploiter le territoire. Du début du XI° siècle à la fin du XII° peu à peu les champs permanents prennent la place des essarts et les semailles en deux saisons sont instaurées : froment et seigle après les labours d’automne, orge et avoine après les labours de mars. Le nombre des habitants croît en fonction de ses installations et de l’agrandissement des terres mises en cultures.
L’artisanat
Les premières activités artisanales sont concentrées sur la rivière d’Yvette, autour des trois moulins recensés pour le haut Moyen-Age. Pour les installer il a fallu modifier le cours de l’Yvette qui s’étendait plus largement et créer une boële (moulin de La Roche), canal régulant la force de l’eau qui fait tourner la roue. Cela n’a pu se faire que par apport de travailleurs de plus en plus nombreux munis de meilleurs outils que l’évolution des techniques transforme. Deux moulins de Villebon traitent les grains, un autre foule les draps. Le chemin des Migneaux relie les moulins à grains de Villebon et de Massy. Le seigneur oblige ses gens à utiliser le four à pain, le pressoir…
Les Villabona, propriétaires d’une grande partie du territoire font travailler des familles d’ouvriers probablement serfs (esclaves). A cette époque d’autres seigneurs possèdent des terres à Villebon, qu’ils font exploiter par des Villebonais : les Religieux Chartreux seigneurs de Saulx à partir de 1264), mais aussi le seigneur de Palaiseau, celui de Champlan, de Vaugrigneuse… chacun perçoit les redevances, notamment les dîmes du blé, du vin... Il est possible aussi qu’un enclos, la Haie du pont, ait été installé pour des marchands ambulants, près de l’ancien pont sur la vieille voie de Chartres par les plateaux…
La culture
L’augmentation des familles sur les terres vient d’une production qui s’améliore, les enfants plus nombreux sont « des bras » pour le travail quotidien. Les activités agricoles, la vigne (à la Plante des Roches, un clos) et l’extension des cultures (Les parts) et de l’élevage (le Préau), mais aussi les arbres à fruits, des châtaigners (1), des saussaies (saules) et bruyères couvrent essentiellement les coteaux de la Roche, les terres du château de Villebon et de sa ferme seigneuriale de Villiers, cultivés pour une part par des familles serves, dont on retrouve des noms dans les censiers (4)
Quelques « hôtes » étrangers sont installés par les seigneurs, les laïcs Villabona, ou les Religieux, des prieurés parisiens Sainte Catherine du Val des Ecoliers, ou locaux : St Eloi de Longjumeau, Bénédictins de Saumur et Chartreux à Saulx (3) : ce sont par exemple les « accolae » (vault accolae = Vatencul), des familles errantes installées aux franges du domaine seigneurial, à qui sont donnés des lopins de terre à essarter puis à cultiver sur les coteaux au-dessus des Casseaux.
Quels rapports entre Seigneurs et villageois ?
Les Seigneurs laïcs sont très souvent absents de Villebon (5) : ils vivent à Paris, ont leurs activités militaires (forteresse de Montlhéry, Croisades, guerres) ou de création de lieux sociaux (maladrerie de Palaiseau sur le territoire de Villebon : la Haarderie). De ce fait Villebon, au contraire des autres villages (Villejust, Champlan, Saulx, Palaiseau) reste un domaine laïc très lié au pouvoir royal et ses seigneurs prennent des postes clefs (2) qui les éloignent du village dont ils tirent quelques profits. Des Régisseurs les représentent.
(1) En 1105, Hugues de Villa Bona a un arpent de pré près (du village) de Villebon, un hôte et son hostise comprenant une vigne et un sextier de châtaignes (Polyptique de Longpont CCXXXV)
(2) En 1196, Naissance de Gautier, fils de Lambert de Villebon. De 1196 à sa mort en 1205, il sera grand Chambellan de France (chambellan, officier chargé du service de la chambre d’un souverain, en anglais est devenu Chamberlain). Orson de Nemours lui succèdera à ce poste (né en 1165 – mort en 1233). Son fils Pierre de Nemours sera évêque de Paris de 1208 à 1219 (il est appelé Pierre II de La Chapelle ou de Nemours), de 1208 à 1219. En 1285, Hugues de Villebon, collecteur d’impôts du roi Philippe IV le Bel (1268 – 1285 -1314)
(3) En 1264, les Religieux Chartreux deviennent seigneurs temporels de Saulx ; propriétaires d’un établissement important à Vauvert près de Paris, ils acquièrent une partie du fief des Tournelles, sur Saulx et Villebon, la dîme du blé, la dîme du vin, et le four banal en 1285 revendiqué par Philippe le Bel en 1289.
(4) Philippot de Villebon vendit, le 7 décembre 1260, à Simon Pasté 20 arpents de terres à Saulx (Terrier, 59 H3).
(5)1270, Lambert de Trie, seigneur de Villebon, part en croisade avec Louis IX (1215 – 1226-1270, Saint Louis), meurt à Tunis.

En haut à droite, au bord de l’Yvette, l’ancienne Bretèche ?
(plan n°7 du Terrier des Chartreux de Saulx, 1730, AD91, 59 H06)


La vie à Villebon fin XIV° siècle, début XV° siècle (4)
Quel aspect Villebon peut-il bien avoir à la fin du XIV° siècle ? Autour du village,
le coteau sud est couvert d’un vignoble sur Saulx et Villebon. Le lieu est dit Loizeau
à Saulx (du nom de famille Loisel) et aussi Passavant et appartient aux Religieux
Chartreux, dont quelques-unes au Prieur lui-même. Les vignes de Villebon sont cultivées
par un certain Fusée qui les cède à Jehan Picquet. Guillaume des Vignes, laboureur
de Villebon, y tient un demi-arpent de vigne au lieu dit « Groueslières » devenu
les Grouettes.
Au bord de l’Yvette les enfants de feu Thomas Robin, de Villebon, tiennent cinq arpents
(près de deux ares) de prairie qu’ils avaient achetés aux Religieux de Saint Eloy,
de Longjumeau. Le long de la rivière, vers 1430, un sentier est « élevé » (aménagé)
dans la propriété d’Henri Desvaulx qui joint la Planche aux Vaches (Saulx) au village
de Villebon. Tout près un certain Picquart, de Villebon, a « trois quartiers » de
prés sur les rives de l’Yvette.
Du côté de Villiers, le long du chemin de Montlhéry et jusqu’au pont, au bord d’un
« ruissel » appelé « le ru du pré entre deux » le lieu est dit Grand Sénevé : il
s’agit peut-être de la culture d’une variété noire de la fleur à moutarde ; la sauce
moutarde est très utilisée au Moyen âge en cuisine ; les feuilles cuites sont comestibles
comme le choux. Le lieu dit Galanne, aujourd’hui Galène (bois et pont de Galène à
Villiers), est un indice précieux : il semble révéler des activités minières anciennes
dans ce secteur. En effet la galène est le nom de la masse rocheuse contenant un
alliage de minerais de plomb, cuivre et or ou argent.
Au bord du ruisseau de paradis quelques bosquets et des Saussayes, ancien nom de
Saulaies. Le bois de cet arbuste poussant dans les lieux humides est très utilisé
pour la fabrication des manches d’outils, des gaules et perches, et surtout dans
la vannerie. L’écorce de saule est également utilisée pour ses vertus curatives et
l’eau de saule facilite le bouturage des plantes.
Le Censier des Religieux Chartreux de Saulx cite les noms de Villebonnais astreints
à l’impôt dû au seigneur ,de Saulx en 1401 pour des biens sis à La Roche. Ainsi trouve-t-on
les terres de Jehan Raoul, Jehan Le Tourny, Robin Bonnes, Jehan Le Tonnelier, Jehan
Le Picart, et les vignes de la maladrerie de Palaiseau - qui est peut-être située
sur le territoire de Villebon, de Thevenin, de Jehan Roux, de Bouchart, de Berthelin
Aboelart, de Michel de Grès, la saussaye et le jardin de Jehan Le Brun devant le
moulin de La Roche, le pré de Jehan Le Maire, au lieu dit Chemineau, le pré proche
de l’Yvette de Maistre Michel Marchant, les maisures des héritiers de feu Philippot
Berelle, de Boursin, la maison de Harvet et la maisure de « la harvete » (c’est-à-dire
la femme de Harvet), près de chez Tonin… Ainsi apparaît une quinzaine de familles
parmi les plus aisées de Villebon à cette époque médiévale. Le moulin de la Roche
est alors propriété des religieux de Saint Eloy à Longjumeau (1388). Il moud les
blés et ne pratiquera le foulage des draps que deux siècles plus tard. Un chemin
dit des Migneaux joint ce moulin à celui de Massy.
Les fermes de Courtabeuf et de la Plesse sont des fiefs. En 1400 les bâtiments de
Courtabeuf appartiennent à l’échanson du roi Guillaume de Harville et sont installés
sur un demi-hectare de terres et La Plesse en 1407 dépend du seigneur Jehan de Lagny,
écuyer.
Il est difficile d’imaginer les Casseaux puisqu’ils ont brûlé en 1795. Mais on peut
penser que ce secteur est bâti en de nombreux hameaux autour d’un chemin très fréquenté
joignant Palaiseau à Villejust : le moulin de la Planche, les bas Casseaux, la ferme
de la Madeleine et celle de l’hôtel Dieu (qui sont peut-être les mêmes), les Gâtines,
les Gelles autour d’une fontaine, les hauts Casseaux, la Plesse… avec des cultures
sur les coteaux sous Villefeu. Les hameaux comptent quelques masures assez basses
car enfoncées dans le sol et sans étage. Seules les fondations peuvent être en pierre
mais les murs sont en bois, torchis et la toiture en chaume de bruyère ; un hameau
de Villebon près de la haute Roche s’appelle La Brière. En 1401 le Censier de Saulx
relève une seule maison « neuve couverte de tuile ». Seuls le château de Villebon
et la maison prieurale de Saulx sont en pierre. De cette époque il reste pourtant
aux Casseaux un superbe puits en pierres de grès.
La Guerre de Cent Ans continue de faire des ravages : la bataille d’Azincourt en
1415 révèle une fois de plus la supériorité anglaise. Les seigneurs mobilisés dans
les batailles n’ont plus le temps de se préoccuper de leurs terres et les habitants,
dont le nombre diminue, sont pressurés d’impôts. Mais le pire reste à venir…
Pierre GÉRARD
Pierre GÉRARD
Atelier "Le Temps des cerises" de la MJC Boby-Lapointe.
Retrouvez tous les textes sur http://histoiredevillebon.free.fr
La margelle du puits en belles pierres de grès, dans la cour du 30 bis rue des Casseaux
(février 2005) peut-être du XV° siècle




