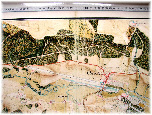Au cours de sa déjà longue histoire notre département a vu son sol envahi à de nombreuses
reprises. Les peuples gaulois s’installent en 600 ans avant notre ère, les armées
romaines le conquièrent en - 52, puis les Francs au III° siècle, les Normands au
IX°. Les rivalités entre rois d’Ile-de-France et puissants seigneurs locaux amènent
même à une période où les rois d’Angleterre revendiquent le trône de France. Bien
des malheurs sont dus aux guerres de cent ans, du bien public, de religion ; enfin
l’horrible période de la fronde décime la région dans les années 1650. En arrêtant
là ce bilan guerrier, il est évident que chaque fois notre commune a été un enjeu
et on trouve encore des traces de ces affrontements successifs.
Lieux de passages préhistoriques
Le village est en situation dominante au confluent de l’Yvette et du Paradis. Avant
même la période historique il est un carrefour où se croisent des peuples nomades.
En effet la construction de la ligne TGV (1985) révélé au lieu dit Les Sablons des
vestiges de ces passages : outils et parures décrits par Christian Montenat comme
étant du Néolithique. Les Dréas, peut-être d’anciens chemins utilisés pour les migrations,
croisent aux Sablons la voie gauloise de Lutèce à Briis. En amont se trouve les
lieux dits la Pierre longue, autre nom du dolmen, et les Beaumonts, un lieu parfois
encore doté de monolithe (exemples de Leudeville en Essonne ou de Villebon en Eure-et-Loir) ;
Beaumont est souvent interprété comme un ancien *Belenos mons, le dieu solaire gaulois :
remarquons que notre site est très bien orienté. Enfin sur les rives du ruisseau
de Paradis fut découvert voici quinze ans une hache polie, petit outil rituel. Ces
quelques attestations expliquent que les hommes se soient installés là voici très
longtemps.
Quelle sorte de Gaulois ?
Le nom même de Villebon est probablement d’origine gauloise (*bodina > bona, borne
frontière). Cette limite de territoire à l’époque gallo-romaine peut représenter
une frontière de peuples, où est installée une enceinte fortifiée et défendue par
une troupe. La rivière Yvette avec sa vallée profonde marque une séparation nette
entre les sites fortifiés de sa rive gauche au nord (Palaiseau) et sa rive droite
(Villefeu). Au sud-ouest Bonnelles (Yvelines) est aussi sur la route de Chartres…
Sommes-nous alors en pays Parisii, Carnute ou Sénon ? La question mérite d’être posée,
parce que les limites entre Carnutes et Sénons sont fluctuantes, ces deux peuples
étant des fédérations, les Parisii, n’apparaissant qu’au 1er siècle avant notre ère
comme une partie du peuple Sénon. Ou bien les Ligures, prédécesseurs des Celtes auraient-ils
résisté à cet endroit ?
Villebon et Villefeu furent-ils des postes avancés des Carnutes ou une place forte
des Parisii ? Seules les recherches au sol pourraient nous donner des preuves…En
tout cas notre territoire fut âprement convoité.
Notre dernier article posait la question de la peuplade gauloise à laquelle appartenait
Villebon : Carnutes (région de Chartres) ou Sénons(région de Sens comprenant alors
les gaulois Parisii) ? La frontière entre les deux peuples installés depuis –600
a été mouvante jusqu’à la conquête romaine. Le dernier « changement » est celui opéré
à l’époque des gallo-romains, lorsque colons romains et responsables gaulois commencèrent
à unir leurs efforts. L’empereur Auguste favorisa le développement des « cités »,
fixant pour longtemps les limites entre anciens peuples gaulois. Le commerce remplaça
la guerre et les révoltes. Les villes capitales prirent une importance considérable,
les campagnes commencèrent à travailler pour les villes. Villebon, situé aux franges
de ces cités fut rattaché à celle de Paris, Bonnelles à celle de Chartres.
Reste-t-il des traces de l’époque gauloise ?
Que peut-on encore distinguer dans à Villebon ou dans les environs de cette époque ?
Outre les voies principales : voie de Paris à Chartres, voie de Paris à Orléans dont
l’importance est renforcée, la route qui les relie, l’actuelle départementale 59,
reste un axe gaulois de campagne. Son nom au XV° siècle « le grant chemin de bris »
utilise encore des mots du vocabulaire gaulois : « grant » = grand, « cama » = chemin,
Bris, appellation gauloise de Briis sous Forges.
Aujourd’hui 7 lieux-dits de Villebon sur 70 sont d’origines gauloises : le Plan,
le Vatancul (Vault-accula, équivalent de « fault », confluence), Yvette (du nom de
l’if), Georgette (gorge, gorgone), Dréas (chemin anciens), Beaumont (Belenos), arpent
(ancienne mesure gauloise) et bien sûr le « bon » de Villebon, ancienne « bodina »
(borne gauloise).
Les structures fortifiées
Villefeu comme Villebon comportent des vestiges de fortifications visibles, qui peuvent
avoir été édifiées à l’époque gauloise. Nous avons déjà cité l’enclos de Villefeu :
il comporte des traces de murs extérieurs et des buttées, dont l’étude permettrait
de les dater. Au village de Villebon, dans le parc du château, j’ai découvert un
enclos très semblable et, semble-t-il encore mieux préservé. L’ancienne ferme de
la Plesse, sise dans l’espace face au Grand Dôme actuel, était également entourée
d’un enclos fossoyé. Son nom latin « plesseium » indique qu’il fut à l’origine un
lieu entouré de palissades.
Une colonne de l’ancienne villa gallo-romaine ?
Il est possible qu’une « villa », propriété agricole gallo-romaine, ait succédé à
un habitat gaulois, au village de Villebon. Elle a été située derrière la tour ronde
dans le parc du château, mais elle occupait un espace d’une centaine d’hectares,
allant du village jusqu’à Villiers.
Par sa forme sculptée la petite colonne blanche installée près de la source Sainte
Geneviève, dans le parc du château, en serait probablement un vestige. Espérons qu’un
jour les moyens de vérifier ces pistes seront enfin à portée des chercheurs.


La trace des Francs
A la fin du V° siècle, tandis que Clodion, Mérovée et Childéric, rois des Francs
saliens, se taillent un territoire au nord de Paris, l’empire romain tient encore
les principales villes de Gaule. Les régions de la Bretagne à la Champagne et entre
Seine et Loire ont gardé leurs traditions , traditions gauloises au point qu’elles
sont désignées « les Armoriques ». Les habitants gaulois et romains se sont assimilés
: Lutèce est gallo-romaine comme Orléans et Auxerre, où exerce le seigneur Germain,
consacré évêuqe en 418.
Geneviève à Villebon ?
Les chrétiens sont alors de petits groupes actifs dans les localités importantes,
dynamisés par leurs évêques. La bergère gallo-romaine Geneviève, fille de Severus
et de Gerontia, naît en 422 à Nanterre ; Germain d’Auxerre, de passage dans sa ville,
la convertit. A la mort de ses parents, elle s’installe chez son oncle à Lutèce,
puis elle part sur les routes du royaume pour faire partager ses convictions. En
448, en se rendant dans la forêt de Séquigny , elle aurait fait étape à Villebon.
Le souvenir de son passage confirme l’existence du village, sur la voie de Lutèce
à Briis; elle dut passer la rivière sur un pont aujourd’hui disparu, mais encore
indiqué au cadastre napoléonien. Au village elle fut reçue près d’une source, aménagée
bien plus tard.
Attila battu
En 406 les Vandales prennent Reims, tuent l’évêque Nicaise. En 451 Attila, chef des
Huns, menace le val de Seine, suscite une grande peur. Les parisiens fuient, Geneviève
les retient : Vous serez encore plus mal gardés ailleurs ! Attila, ami d’enfance
du général romain Aétius - ils ont été élevés ensemble à Rome -, ne s’est jamais
opposé à lui. Le Franc Mérovée et le Romain Aetius, alliés pour la première fois,
dissuadent Attila de prendre Lutèce. Les Huns passent près de notre contrée, en route
vers Orléans, ville à laquelle ils renonceront aussi. Attila sera refoulé jusqu’en
Champagne par Mérovée, c’est la première victoire du Royaume Franc en constitution,
qui chassera en 455 les Saxons, puis les Chattes (Francs du Neckar). En 461 Lutèce
gallo-romaine est assiégée par les francs de Childéric. Geneviève s’échappe en barque
vers Troyes et en rapporte des vivres pour lutter contre la famine. En 475 Geneviève
agrandit son église à Catulliacus, futur Saint-Denis. En 476 Childéric combat des
Alains installés à l’ouest de notre région (Alainville, Yvelines). La même année
l’empire romain s’écroule.
Les Francs fortifient notre région.
Clovis, roi des Francs en 481, se fait baptiser vers 496. Il réussira l’union avec
les Gallo-romains et aura l’appui de l’Eglise catholique pour se rendre maître de
Lutèce. Il devra patiemment reconquérir le sud de l’Ile-de-France. En pays de Châtres
(futur Arpajon), il bâtit ou consolide des forts à Longjumeau, où se trouve un très
important cimetière mérovingien près de l’église Saint Martin, à Montlhéry, à Villebon
et à Palaiseau, où un petit palais lui permet de recevoir pour des réunions importantes,
ses Leudes.

Le temps des Mérovingiens
Le pays de Châtres (pagus castrensis) a été créé au 6° siècle, sur l’axe de la voie
Paris-Orléans (future route nationale 20). Cette nouvelle organisation territoriale,
œuvre des Francs Mérovingiens, est dirigée par un Comte, un fidèle compagnon du roi.
La loi salique (507-511) donnant à chacun le droit de propriété, et la création des
pays, subdivision des civitates, permettent d’améliorer les rapports entre gallo-romains
et francs. Quels sont les contours du pays de Châtres ? La civitas Parisiorum (territoire
des Parisiens) semble finir au sud avec Antony. Châtres, qui deviendra Arpajon 1200
ans plus tard, est née autour d’un camp (castrum) de légions romaines. Le pays de
Châtres est peu peuplé, très boisé. Il sera fortifié pour défendre l’accès de Paris.
Il commence au Nord, avec Villebon (Villa Bona), Champlan et Wissous, d’où naît l’aqueduc
de Julien apportant les eaux à Paris. Dans ce village une pierre levée dite la Bonne
restera visible jusqu’au 16° siècle. Au Sud la limite devait être Bonnes (futur Chamarande).
Le nom gaulois de ces lieux, bona, borne, puis village, n’est pas un hasard.
Childebert Ier (vers 497- 558), fils de Clovis, hérite en 511 le plus petit royaume,
celui de Paris ; il recevra celui d’Orléans à la mort de son frère Clodomir en 524.
Jusqu’en 558 il se battra pour constituer un royaume à la taille de l’ancienne Gaule.
Dès 512 il construit à Palaiseau un petit palais, où il réunit ses compagnons. La
consolidation du pays de Châtres est vitale pour Childebert, car c’est le point de
départ de la réunion de tous les royaumes francs (Austrasie, Neustrie). Il conquiert
la Burgondie (future Bourgogne) de 524 à 534, et achète la Provence en 536-537. Clotaire
Ier (vers 497-561), frère de Childebert, est roi d’Austrasie (à l’Est). Ils co-dirigent
la Neustrie (à l’Ouest), Orléans, la Burgondie et Paris. En 542, ensemble ils guerroient
en Espagne et rapportent de Saragosse l'étole de saint Vincent, en l'honneur de qui
il firent bâtir une église, intégrée par la suite dans l'abbaye de Saint-Germain-des-prés,
dont le premier abbé fut Irminon. Dagobert 1er (623-639) réussit à maintenir le
royaume uni (Neustrie, Austrasie, Bourgogne). Il créa l’abbaye Saint-Denis, à qui
il céda en 636 le village de Saulx. Il eut des conseillers très expérimentés dont
Saint Eloi (588-660), venu de Limoges, qui fut d’abord orfèvre, puis trésorier de
Clotaire II. Le prieuré Saint-Eloi de Longjumeau fut créé en 1234. En 663 Saint Wandrille,
abbé de Fontenelle, rendit visite au roi Clotaire III, à Palaiseau, au pays de Châtres.
Villebon et les rives de l’Yvette demeurent boisés, avec de petits foyers de peuplement
au village, à Villiers et aux Casseaux. Les terres de la villa gallo-romaine sont
cultivées par quelques familles de paysans utilisant encore l’araire, vivant de la
cueillette (glands, châtaignes) et de bouillies ou galettes faites d’orge ou d’avoine.
Il est probable que le hameau de Villiers s’est développé autour des bâtiments agricoles
à partir de cette époque.

Les Vikings en Essonne
Le grand territoire de Palaiseau
Les 5000 hectares sont une circonscription administrative à but fiscal : la vallée
de l’Yvette (Villebon, Orsay) et les plateaux qui l’entourent (Saclay, Vauhallan,
Villejust) sont un ensemble cohérent. En 530 un incendie gigantesque avait ravagé
Palaiseau et ce village resta désert assez longtemps. Du 7° au 9° siècle pour reconstruire
et partager les terres les rois les donnèrent à gérer aux seigneurs religieux, évêques
et abbés. Au 7° siècle, l’orfèvre Eloi, devenu monétaire de Clotaire II, puis évêque
de Noyon, se fit construire une maison de retraite au bord de l’Yvette, en parties
sur Longjumeau et Chilly-Mazarin : sur cet emplacement fut construit le prieuré en
1234, par Jean de Dreux et Alix de Mâcon. En 622, Saulx était donnée par le roi Dagobert
à l’abbaye Saint Denis. Au 8° siècle Pépin le Bref donne ce territoire à l’abbaye
Saint-Germain-des-prés, dont Irminon (811-819) fut Abbé, auteur du célèbre polyptique
(cartulaire) sous Charlemagne. Mais qui protégeait les habitants ?
Des gens du Nord
A partir de 793 commencent ce qu’on appelle, à tort, les invasions des Vikings. Ces
commerçants Scandinaves, venus du Danemark, profitant de la désorganisation complète
et des rivalités entre petits royaumes s’installent en Angleterre du sud ; dès 819
ils débarquent à l’embouchure de la Loire : par petites équipées rapides ils fondent
sur des cibles bien déterminées, dérobent les « trésors » des chapelles et églises
mal défendues, puis se retirent sur leurs bases. En 841 ils terrorisent les habitants
des rives en remontant la Seine jusqu’à Rouen, puis pillent l’île de la cité de Paris
le 28 mars 845. Le roi de France, Charles le Chauve, au lieu de les combattre, leur
offre 7000 livres d’argent. Dès lors les Vikings seront tentés de poursuivre leurs
incursions. Cela dura tant qu’en 911, Hrolf traitera avec le roi Charles le Chauve
à Saint Clair sur Epte : il devenait « maître du pays de Caux », et, nommé Rollon,
duc de Normandie, vassal du roi de France. L’intégration s’était faite à une rapidité
étonnante, mais Paris s’était affirmée comme la vraie capitale du royaume.
Quelles traces des Vikings à Villebon ?
Les Vikings - soldats, chevaux et matériels, remontaient les rivières et même les
petits ruisseaux sans aucune difficulté, sur leurs bateaux plats ; ils savaient porter
sur terre ces bateaux et passer d’une vallée à l’autre. Pour résister les lourdes
armées sont inutiles ; bientôt des forts sont construits, d’abord en bois puis en
pierre, ce sont les fertés, du latin firmitas, élevées souvent au bord des rivières,
à côté des églises. En 852, le roi Charles le Chauve demande à Robert le Fort, ancêtre
des capétiens, de construire des fertés, dont La Ferté-Alais. Fretay, hameau de Villejust,
fut peut-être une ferté, une butte élevée pour un petit fort, sur la voie de Briis.
Les enclos fossoyés du parc du château de Villebon et de Villefeu ont peut-être encadré
des fertés de cette époque, de même l’enclos de la ferme disparue de la Plesse ou
celui de la source du ruisseau du Paradis pourraient bien avoir été creusés pour
protéger les habitants des assauts Vikings.
Courtabœuf
Ce lieu-dit sur Villebon et Orsay (aujourd’hui Les Ulis) possède un nom a consonance
scandinave. Je suggère que cette terre agricole, sise entre deux villages, a connu
l’implantation d’étrangers nordiques lorsque la période des incursions se termina.
sise entre deux villages, a connu l’implantation d’étrangers nordiques lorsque la
période des incursions se termina. Son ancien nom Courtabeuf contient en effet le
latin * curtus, court, petit et le scandinave *both, maison, comme dans Elbeuf, Criquebeuf.
L’origine de ce lieu serait donc une petite maison, qui avait un avenir intercommunal
certain.




La bataille de Maldestor
Le X° siècle est une période fondatrice pour la France, à commencer par l’Ile-de-France,
et les habitants des communes du nord de l’Essonne en ont connu et subi les avantages
et les inconvénients. On se souvient que courtabeuf (sans o dans l’e) est peut-être
la marque d’une installation danoise (Viking) ; en effet leurs assauts sur Paris
et sa région, amplifiés à partir de 885, ne furent contenus que par de l’argent versé
et des terres données. Ainsi le calme se fit lorsque Rollon devint Duc de Normandie
par le traité de Saint-Clair-sur-Epte (Vexin) en 911.
Anarchie
La période est troublée et les rois de France ne parviennent pas à s’imposer. Les
seigneurs gouvernent sur leurs propres terres. C’est ainsi qu’en 950 Hugues le Grand,
duc des Francs, en tant qu’abbé de Saint-Germain des prés, confie à son compagnon
Guérin 1er, comte de Paris, le vaste domaine de Palaiseau dont Villebon est partie
prenante. Guérin, comme son successeur Garnier sont de la très importante famille
Le Riche - de rijk ou der Reich, nom d’origine normande, signifiant l’Etat, une des
familles franciliennes soutien de bien des générations royales.
L’hiver très rude et la guerre
En 974-975, l’hiver fut rigoureux et long, du début novembre au 22 mars, et la neige
tomba encore en mai. On estime que cette année-là, la famine tua le tiers de la population
française et la moitié des franciliens. Fin 978, l’empereur germanique Otton II met
le siège devant Paris, puis s’éloigne… On imagine les difficultés des populations
déjà restreintes, menacées par la guerre permanente et par des conditions climatiques
désastreuses.
Une nouvelle dynastie
C’est la fin des Carolingiens. Une branche de la famille, les successeurs de Robert
le Fort, comte d’Anjou et de Blois, prend le pouvoir : Hugues Capet, fils d’Hugues
le Grand, est sacré roi de France le 3 juillet 987. Il doit combattre les grands
seigneurs pour s’imposer, notamment Eudes 1er de Blois, seigneur du comté de Blois
et de la Champagne, qui enserre le petit royaume français. Il ne peut compter que
sur le comte de Corbeil, Bouchard, dit le vénérable, qu’il a fait aussi Comte de
Paris. En 991 le château de Melun, propriété du roi donnée en garde à Bouchard, est
prise par le comte de Blois. Le lieutenant de Melun Gautier et sa femme, accusés
de traîtrise furent pendus. La haine entre Bouchard et Eudes augmenta.
Maldestor
En 992 le roi occupé à guerroyer au nord laisse Bouchard seul défendre l’ouest. Il
gagne des alliés et se dirige contre Eudes de Blois, qui est soutenu par Richard
1er, duc de Normandie. Le choc des deux armées fut très violent. Il se déroula sur
le plateau, qui s’étend devant les forts de Villefeu et la Plesse jusqu’à Orsay,
des lieux où survivaient des familles de serfs dans de misérables cabanes. Les soldats
du comte de Blois se heurtèrent à l’armée du comte de Corbeil en des combats très
violents. Cette bataille dite de Maldestor, c’est-à-dire mauvaise rencontre, (Mondétour),
que certains placent en 999, vit le massacre de l’armée du comte de Blois. Il est
tout-à-fait possible que ce fut à cette occasion que le château en bois édifié à
Villefeu, brûla, placé à l’avant-garde des terres royales, ou bien poste tenu par
des amis du comte de Blois. Cette bataille indique l’importance des lieux, sur le
chemin de Paris à Chartres, pour la construction du royaume de France : Villefeu
devint un fief à renforcer. Pour notre secteur cette bataille marque aussi la fin
des incertitudes frontalières.
Pierre GÉRARD



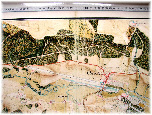
Au 8° siècle, les difficultés des rois mérovingiens les poussent à distribuer leurs
terres. Ainsi le territoire de Villebon commence à être défriché sur des « parts »,
petites propriétés concédées. Des vignes apparaissent à Champlan et Villebon : le
souvenir semble en avoir été conservé à la Roche, avec le lieu dit Les Parts et le
sentier des parts.
Pépin le Bref (751-768)Pépin le Bref (751-768)
Le premier roi carolingien, fils de Maires du palais des rois mérovingiens, donna
en 754 le territoire de Palaiseau, dont Villebon, à l’abbaye Saint-Germain-des-prés.
Puis en 768, il offrit à l’abbaye Saint-Denis l’immense forêt d’Yveline, jouxtant
notre « pays » à l’Ouest et au Sud, dont Actricomons : Montlhéry.